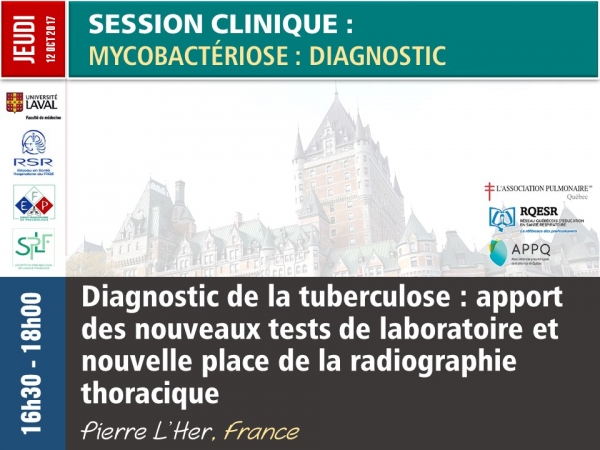Séance N°4 (3)
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Comprendre les deux profils épidémiologiques très différents de la tuberculose au Québec;
- Apprécier l'importance de la détection de cas dans la lutte contre la tuberculose et de connaître le rôle des pneumologues dans la détection des cas contagieux de tuberculose;
- Savoir quelles analyses (tests) ordonner et quelles analyses éviter lorsqu'il traite un patient soupçonné d'être atteint de tuberculose active.
Je vais passer en revue l'épidémiologie mondiale de la tuberculose et ensuite mettre en lumière les deux profils épidémiologiques distincts de la tuberculose au Canada. Je décrirai des recherches récentes sur une épidémie majeure de tuberculose au Québec et les leçons apprises.
Je soulignerai le rôle des médecins de première ligne, y compris les pneumologues, dans la détection de la tuberculose et, par conséquent, dans la prévention de la transmission de la tuberculose ainsi que l'examen des méthodes de diagnostic actuelles.
La tuberculose (TB) reste une des principales causes de morbidité et mortalité dans le monde, le poids de la TB/VIh, surtout en Afrique, et des multi-résistances (MDR) aggravant la situation. Renforcer partout le diagnostic précoce de la maladie est indispensable, pour atteindre le nouvel objectif de l’OMS, fin de l’épidémie mondiale de TB pour 2030.
Le diagnostic au laboratoire, a fait d’immenses progrès, peu accessibles aux pays pauvres de forte endémie. Dans ces pays, le diagnostic repose sur l’examen direct d’expectoration des patients symptomatiques, qui dépiste < 50 % des cas de TB. Lorsqu’elle est disponible dans le pays, la culture ne l’est que dans la capitale. Depuis 2011, le test Xpert MTB/RIF (Cepheid), utilisable partout, permet, en 2 heures, le diagnostic de TB par PcR automatisée et le diagnostic de résistance à la Rifampicine. Les TB MDR, sont maintenant diagnostiquées précocement. Recommandé par l’OMS, ce test s’est rapidement développé [1]. Plus sensible que l’examen microscopique, il augmente les TB à bactériologie positive.
La sensibilité annoncée, proche de la culture, du nouveau test Xpert ultra laisse présager l’utilisation accrue de ce test moléculaire, avec un coût important pour les programmes nationaux TB (PnT). Le cliché thoracique, peu spécifique mais très sensible, qui dia- gnostique les TB thoraciques à bactériologie négative, a longtemps été jugé sans intérêt (images multiples dont aucune spécifique, variabilité inter lecteurs, difficultés techniques, manque d’appareillages et de médecins formés). un récent rapport de l’OMS [2] reconsidère la radiographie comme outil de triage et de diagnostic à placer au début des algorithmes de dépistage pour sa grande sensibilité, l’immédiateté du résultat avec la radiographie numérique. Les algorithmes comparés de dépistage, devant tout symptôme TB compatible, montrent que le cliché est un filtre coût-efficace avant un test Xpert. Le diagnostic assisté par ordinateur (“CAD4TB”²), très sensible pour les petites lésions, mais non spécifique, n’est pas recommandé dans ce rapport.
L’examen direct de l’expectoration, peu coûteux, avec du personnel entrainé et un contrôle de qualité codifié, doit rester la base du dépistage. Pour les cas à microscopie négative, l’utilisation raisonnée du cliché thoracique et de l’Xpert améliore l’efficacité diagnostique. cette complémentarité est illustrée par les séquelles TB, fréquentes, dont les images impressionnantes sont facilement reconnues par un médecin entraîné, dont l’évolution naturelle est la surinfection, avec symptomatologie bruyante (fièvre, expectoration purulente, hémoptysie,…) conduisant souvent à un retraitement TB indu. La reprise évolutive de TB, systématiquement envisagée, est improbable et le traitement TB inutile si microscopie et Xpert sont négatifs ; en cas de microscopie positive, il faut aussi demander l’Xpert, sa négativité signera une surinfection par mycobactérie atypique, fréquente sur séquelles. La formation à la lecture du cliché (faite par SPI dans 16 pays) est fondamentale pour améliorer la spécificité de la Rx : actuellement les médecins prescrivent un traitement TB pour de volumineuses opacités non TB, mais méconnaissent les lésions TB minimes, reconnues par un médecin formé. Les Pn doivent lever les nombreux freins à l’emploi de la Rx, insuffisance de formation, diffusion insuffisante de la Rx numérique, non gratuité de la radio, absence d’enregistrement de l’activité radiographie. L’union a organisé en 2017 à cotonou une formation de formateurs, seniors de 8 pays, pour diffuser les formations dans les pays. Mettre en place une assurance externe de qualité (EQA) de l’interprétation est nécessaire. TeAM et SPI conduisent au Myanmar une phase pilote EQA avec enregistrement des résultats en 6 catégories de Rx : normale, anormale suggestive de TB, anormale suggestive d’autres maladies, non concluante, séquelle de TB et non lisible, qui pourra servir d’exemple pour l’implantation dans d’autres pays.
Références
- Albert H. Development, roll-out and impact of Xpert MTB/RIF for tuberculosis: What lessons have we learnt and how can we do better? Eur Respir J 2016;48:516-25.
- WhO, chest radiograohy in TB detection summary of current WhO recommendations and guidance on programmatic approach, geneva
Une infection tuberculeuse latente (ITL) est un état caractérisé par une réponse immunitaire persistante aux antigènes de Mycobacterium tuberculosis acquis antérieurement, sans signes cliniques d’une tuberculose (TB) active. On estime qu’un tiers de la population mondiale est infecté par M. tuberculosis. Les sujets infectés ne sont pas contagieux, mais sont à risque de contracter une tuberculose active. Le risque global à vie de développement d’une tuberculose maladie après infection par le bacille de Koch a été estimé de l’ordre de 10 %, il est maximal au cours des deux premières années suivant l’infection, puis il diminue. Toutefois, ce risque est accru chez les enfants de moins de deux ans, et dans toute situation entraînant une baisse de l’immunité.
La détection de l’infection tuberculeuse latente demeure difficile et reste le sujet de multiples controverses. En effet, il n’existe pas de preuve formelle de l’ITL, en dehors du développement d’une TB maladie chez une personne infectée.
Les tests diagnostiques de l’ITL regroupent l’intradermo-réaction (IDR) à la tuberculine et les tests de mesure de l’interféron-gamma (IgRA). ces tests diagnostiques sont des tests indirects, ils permettent de mettre en évidence la présence d’une empreinte immunologique d’une infection tuberculeuse antérieure, mais ne permettent pas d’identifier directement une ITL associée à un bacille vivant à risque potentiel d’évolution vers la tuberculose maladie ou d’une infection à bacille quiescent ou de prédire si l’ITL diagnostiquée évoluera un jour. nous pouvons ainsi conclure qu’il n’ya pas actuellement de méthode « gold standard » pour une détection formelle d’une ITL et il existe un risque important d’administrer un traitement préventif hépato-toxique à des patients en réalité guéris et/ou qui ne présenterons jamais une TB maladie.
En partant du principe « intention to test is intention to treat », un dépistage de l’ITL n’a lieu d’être réalisé que si un traitement est proposé au patient afin de réduire le risque de développement de la tuberculose maladie. Ainsi, sur le plan pratique, il faut commencer par l’identification des groupes à risque susceptibles d’être traités pour une ITL.
Les directives de l’OMS pour le dépistage et la prise en charge de l’ITL tiennent compte des ressources disponibles, de l’épidémiologie de la tuberculose, de l’intensité de la transmission, du système de prestations de soins de santé du pays et d’autres facteurs nationaux ou locaux. A l’issu de ces directives, il faut dépister systématique- ment une ITL chez les sujets infectés par le VIh, les contacts adultes et enfants des cas de tuberculose pulmonaire, avant tout traitement immunosuppresseur notamment les anti-TnF, les patients en dialyse, avant toute greffe d’organes et chez les silicotiques. Ailleurs, dans les pays à faible prévalence de tuberculose, le dépistage de l’ITL cible également les migrants provenant d’un pays à forte prévalence de tuberculose.
Références
- Madhukar Pai, Marcel A et Tuberculosis. nature reviews disease primers 2016;2:1-23.
- Erkens cg, Slump E et al. Monitoring latent tuberculosis infec- tion diagnosis and management in the netherlands. Eur Respir J 2016;5:1492-501.