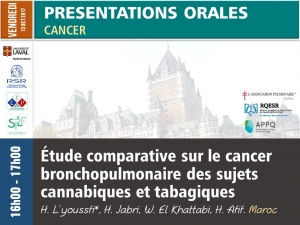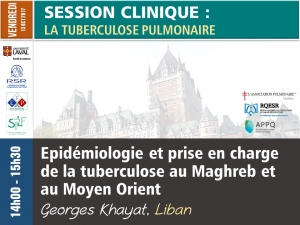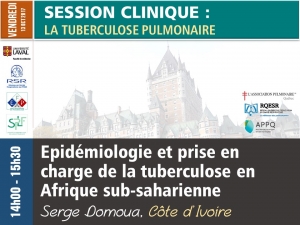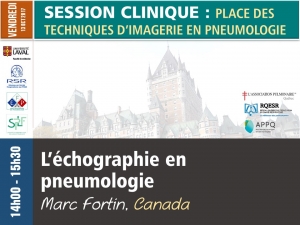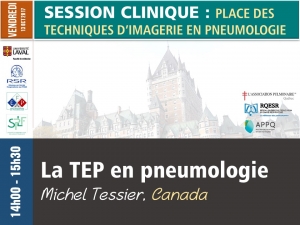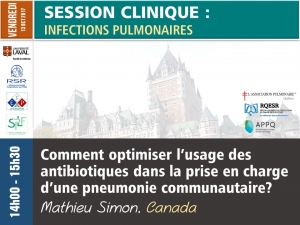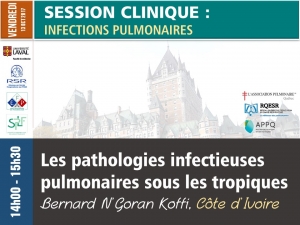Super User
Carcinomes sarcomatoïdes pulmonaires : étude multicentrique rétrospective des anomalies de la voie ME
Introduction La voie hgF/Met est une cible thérapeutique des cBnPc et notamment des carcinomes sarcomatoïdes (cS). Les méthodes diagnostiques comprennent l’immunohistochimie (Ihc) à la recherche d’une surexpression du récepteur Met, la FISh (Fluorescence In Situ hybridization) à la recherche d’une augmenta- tion du nombre de copies du gène MET, et les techniques de biologie moléculaire à la recherche de mutations des sites d’épissage de l’exon 14. L’objectif est de caractériser les patients ayant un cS avec une FISh positive, et d’étudier la corrélation entre FISh, Ihc et mutations.
Matériels et méthodes 81 échantillons tumoraux chirurgicaux provenant de 4 centres français ont été analysés après relecture centralisée. Le nombre de copies de MET était déterminé par FISh (sonde Zytovision, clinisciences) avec mesure du ratio MET/cEP7. La positivité était définie par un nombre de copies ≥ 5/cellule et un ratio MET/CEP7 > 2. La surexpression de Met était mesurée par IHC en utilisant le score MetMAb et le h-score (clone SP44, Ventana). Les mutations de l’exon 14 de MET étaient recherchées par génotypage MassARRAY (Agena Biosciences). cette technique était combinée à un screening hRM (analyse de courbes de fusion à haute résolution). Résultats Il y avait 8,4 % d’amplifications de MET (N = 6). L’âge, le sexe, l’ethnie, le tabac et le stade n’étaient pas corrélés à l’ampli- fication de MET. Seuls les sous-types pléomorphes présentaient une amplification. L’amplification de MET était exclusive des mutations KRAS. Il y avait 4,9 % de mutations de l’exon 14 de MET (n = 4). Aucun patient muté exon 14 ne présentait d’amplification. Les résultats de l’Ihc sont en cours et seront délivrés lors du congrès.
Conclusions Il n’existe pas de corrélation entre mutation de l’exon 14 et augmentation du nombre de copies du gène MET. L’expression de la protéine est en cours d’analyse.
Étude comparative sur le cancer bronchopulmonaire des sujets cannabiques et tabagiques
Le cannabis comme le tabac peut avoir un lien avec l’augmenta- tion importante du cancer bronchique. Le cannabis contient des substances qui ressemblent à celles retrouvées dans le tabac.
Nous avons mené une étude prospective comparative, s’étalant entre janvier 2013 au décembre 2016. nous avons comparé deux groupes : le groupe 1 patients cannabiques seuls et groupe 2 patients tabagiques seuls tous porteurs du cancer bronchique confirmé confirmés histologiquement. Dans les 2 groupes il existait une prédominance masculine. Au plan radiologique, il s’agissait d’un processus parenchymateux périphérique dans 67 % et 75 % respectivement dans les groupes 1 et 2. Au plan endoscopique, les aspects les plus fréquents étaient respectivement dans les 2 groupes, les bourgeons tumoraux endobronchiques (25 et 34 % des cas) et les sténoses infiltratives (20 et 15 % des cas). La confirmation histologique est apportée par biopsie bronchique dans 20 % (groupe 1) et 35 % (groupe 2) et par biopsie transthoracique dans 25 et 19 % respectivement. Parmi les types histologiques, nous avons retrouvé dans les 2 groupes, l’adénocarcinome dans 60 et 57 % et le carcinome épidermoide dans 35 % et 30 %. Selon la classification TNM, nous avons retrouvé respectivement dans les 2 groupes, le stade III dans 60 et 67 % et le stade IV dans 35 % et 32 %.
Le traitement était chirurgical dans un seul cas dans le groupe 1 et dans 25 % des cas dans le groupe 2. cette étude prouve que le tableau clinique, radiologique et histologique ne diffère pas selon qu’il s’agissait de cancer bronchique chez le cannabique ou le tabagique seul, sans valeur prédictive significative. néanmoins, il est important de recommander l’arrêt du cannabis.
Epidémiologie et prise en charge de la tuberculose en Europe centrale et Asie du sud est
La tuberculose est une maladie infectieuse, due au bacille Mycobacterium du complexe tuberculosis. Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), la tuberculose est l’une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. En 2015, 10,4 millions de personnes ont cette maladie et 1,8 million en sont mortes (dont 0,4 million ayant aussi le VIh). Plus de 95 % des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La tuberculose représente encore un problème important de santé publique.
Selon le centre européen de prévention et de contrôle des maladies, en 2014, environ 340 000 cas de tuberculose (de 320 000 à 350 000) se sont produits dans la Région européenne, le taux d’incidence est de 37 cas (35-38) pour 100 000 habitants. cela représente environ 3,6 % du fardeau mondial de la tuberculose. L’Europe centrale est composé de 5 pays : Autriche ; hongrie ; Pologne et République tchèque. Le fardeau de la tuberculose en Europe centrale est parmi les plus bas au monde, mais les immigrants sont connus pour poser de nombreux défis aux programmes de lutte contre la tuberculose et d’élimination dans cette région.
L’Asie du Sud-Est est un ensemble de 11 pays d’Asie regroupés entre l’océan Indien et l’océan Pacifique. Un tiers du fardeau mondial de la tuberculose (TB), soit environ 4,9 millions de cas prévalents, se trouve dans cette région. En 2016, 6 des les 30 pays à forte charge de la tuberculose se trouve en Asie du Sud-Est, y compris l’Indonésie, les Philippines, le Myanmar, le Vietnam, la Thaïlande et le cambodge. Bien que les taux de mortalité dans la région ont diminué en raison de la mise en œuvre réussie de la stratégie du traitement supervisé TDO (traitement directement observé), la maladie revendique environ un demi-million de vies annuellement dans la région. Les grands défis d’aujourd’hui est la co-infection tuberculose-VIh et la tuberculose multirésistante (TB-MR)/ tuberculose ultra-résistante (TB-uR).
La région de l’Asie du Sud-Est représente environ 15 % des nouveaux cas de TB VIh séropositifs. La prévalence du VIh chez les nouveaux patients tuberculeux est de 6,2 %. La nécessité d’aborder d’urgence la co-infection tuberculose-VIh est bien comprise dans la Région. un plan d’intervention régional pour la collaboration tuberculose-VIh, 2012-2015, a été élaboré, en adaptant les stratégies et les lignes directrices mondiales aux besoins uniques de la Région.
Le nombre de cas de tuberculose multirésistante dans l’Asie du Sud- Est représente près de 30 % du monde en 2012. Quatre des 27 pays les plus lourds de la TB-MR se trouvent dans la région de l’Asie du sud- est. Les capacités limitées de laboratoire pour le diagnostic de cas de TB résistants aux médicaments et pour la surveillance, les difficultés à obtenir des médicaments de deuxième ligne de qualité et de longs délais pour l’approvisionnement sont certaines des contraintes. Des ressources supplémentaires substantielles sont nécessaires pour étendre la gestion programmatique de la tuberculose résistante aux médicaments. Plusieurs étapes sont nécessaires pour ameliorer simultanément le diagnostic, le traitement et la surveillance des TB-MR/TB-UR. Ceux-ci incluent un soutien technique et financier aux pays par l’OMS ; Partenaires techniques et financiers ; Les efforts du programme national pour assurer la mise en œuvre de tous les éléments de la stratégie “Stop-TB”, y compris la mobilisation de ressources suffisantes ; Mesures réglementaires visant à assurer une utilisation rationnelle des médicaments ; une politique de lutte contre les infections nosocomiales pour prévenir la propagation et la mobilisation de la communauté pour créer des structures de soutien pour les individus co-infectés par la TB-VIh et les TB-MR/TB-uR.
Epidémiologie et prise en charge de la tuberculose au Maghreb et au Moyen Orient Georges Khayat, Liban
Epidémiologie et prise en charge de la tuberculose en Afrique sub-saharienne
Les estimations de l’OMS indiquent qu’en 2015, 10,4 millions de personnes avaient développé un premier épisode de tuberculose et que les personnes vivant avec le VIh (PVVIh) représentaient 1,2 million (11 %) de l’ensemble des nouveaux cas estimés, la proportion de patients atteints de tuberculose vivant avec le VIh étant par ailleurs, la plus élevée dans la Région Afrique.
En 2014, la proportion de TBMR dans la Région Afrique de l’OMS était de 2,4 % chez les nouveaux cas de tuberculose et de 13 % chez les cas déjà traités. Le rapport 2014-2015 du Bureau Régional Afrique de l’OMS note que l’incidence de la tuberculose est passée de 288 cas pour 100 000 personnes en 2012 à 280 cas pour 100 000 personnes en 2013.
La prévalence de la tuberculose a baissé chez les PVVIh, passant de 100 cas pour 100 000 personnes VIh-positives en 2012 à 94 cas pour 100 000 personnes VIh-positives en 2013. La prévalence de la tuberculose a aussi diminué de 50 % en Ouganda et en République-unie de Tanzanie, par rapport à ses niveaux de 1990.
Le taux de succès thérapeutique obtenu dans la Région Afrique chez les nouveaux cas de tuberculose et les rechutes était en 2014, globalement de 81 % (extrêmes : 34 % en Angola et 90 % en Tanzanie). Les taux de succès thérapeutique obtenu dans la Région Afrique pour les cas de tuberculose résistante à la rifampicine était en 2014, globalement de 54 % (extrêmes : 52 % en Mozambique et 82 % au Kenya).
Trois des pays les plus touchés en Afrique (Ethiopie, Ouganda, République-unie de Tanzanie) ont en 2014, réduit la mortalité liée à la tuberculose de 50 % par rapport à 1990. Ces chiffres reflètent les avancées obtenues grâce aux mesures prises par les États Membres pour lutter contre la tuberculose, qui reste l’une des principales maladies transmissibles de la Région Afrique.
L’échographie en pneumologie
L’échographie a fait une première percée en pneumologie dans les maladies pleurales et son utilisation est maintenant reconnue comme un standard de pratique dans les procédures pleurales. Son utilisation reste limitée à cette indication pour de nombreux cliniciens, mais les possibilités de cette technologie sont beaucoup grandes. Bien que le parenchyme pulmonaire soit principalement constitué d’air qui n’est pas échogène, les artéfacts pulmonaires permettent d’obtenir de l’information précieuse.
Cette présentation abordera les principes physiques de bases derrière l’échographie, les différentes sondes d’échographie et leurs caractéristiques, l’échographie du poumon normal, le rôle de l’échographie dans les pathologies parenchymateuses et dans les pathologies pleurales ainsi que le rôle de l’échographie dans les procédures pulmonaires et pleurales.
l'IRM thoracique
L’imagerie par résonance magnétique des pathologies thoraciques non vasculaires est complémentaire à l’évaluation par tomodensitométrie.
Les différentes indications de l’IRM en pneumologie seront discutées, en soulignant les avantages et les limitations de cette modalité.
La TEP en pneumologie
La TEP-TDM permet d’obtenisimultanément une information ana- tomique et fonctionnelle à haute valeur diagnostique. cet examen est devenu essentiel pour la prise en charge du cancer du poumon (nScLc) ainsi que pour la caractérisation des nodules pulmonaires de nature indéterminée. Il joue notamment un rôle central dans la stadification médiastinale et la détection des métastases à distance, et permet de statuer sur la nature de lésions jugées équivoques par les autres techniques d’imagerie.
Au cours de cet exposé, les principes généraux de la TEP-TDM seront revus à la lumière des développements récents, suivi d’un rappel avec exemples de cas à l’appui sur son importance dans l’investigation des nodules pulmonaires indéterminés et pour la stadification du cancer du poumon, en accord avec les recommandations de l’AccP.
Comment optimiser l’usage des antibiotiques dans la prise en charge d’une pneumonie communautaire?
La pneumonie est en occident la maladie infectieuse potentielle- ment mortelle la plus fréquente. Elle entraîne une morbidité, une mortalité et des coûts sociétaires immenses. Pourtant, depuis une décennie, aucun nouveau consensus ne s’est fait sur la prise en charge systématique et efficace de cette condition. Algorithmes de triage, modalités d’imagerie, dosage des calcitonines, usage précoce des corticostéroïdes, empirisme de couverture sont des sujets sur lesquels une littérature récente mais souvent contradictoire s’est penchée sans conclure.
Alors que l’IDSA et l’ATS nous promettent de nouvelles lignes direc- trices pour le printemps 2018, revoyons l’évidence sur laquelle elles seront basées et tentons déjà d’anticiper le résultat d’une conciliation longue, difficile et incertaine.
Les pathologies infectieuses pulmonaires sous les tropiques
Les infections respiratoires tropicales sont dominées par les infec- tions parasitaires. Leur développement est favorisé par 3 sortes de facteurs : des facteurs généraux en rapport avec l’environnement tropical, des facteurs liés au sujet lui-même et des facteurs liés au parasite.
Ces parasites sont variés, cependant on peut distinguer 4 groupes :
- Les parasitoses ayant une localisation préférentielle dans le c’est l’exemple de la douve pulmonaire et de la pneumocystose.
- Les parasitoses ayant une localisation pulmonaire accessoire. Il s’agit de parasite ayant une autre localisation habituelle mais qui peuvent se retrouver de façon accessoire dans le poumon. Ainsi l’hydatidose. L’amibiase et la bilharziose sont des affections hépatiques ou urinaires et leur localisation pulmonaire peut se manifester
- Les parasitoses n’effectuant qu’un passage dans le poumon. ces parasites peuvent affecter le poumon au cours de leur migration dans l’organisme ; responsable de troubles pulmonaires passagers (syndrome de Les filaires lymphatiques sont une des étiolo- gies fréquentes du poumon éosinophile).
- Les parasitoses ayant une localisation pulmonaire exceptionnelle. D’autres parasitoses comme le paludisme peuvent induire des troubles pulmonaires
En dehors des parasites, des virus entrant dans le cadre des fièvres hémorragiques peuvent être responsables de manifestations pulmonaires.
Les autres étiologies comme les bactéries et les mycoses sont en général ubiquitaires. Leur particularité sous les tropicale tient en leur fréquence en rapport avec l’infection à VIh et les conditions de vie précaire.