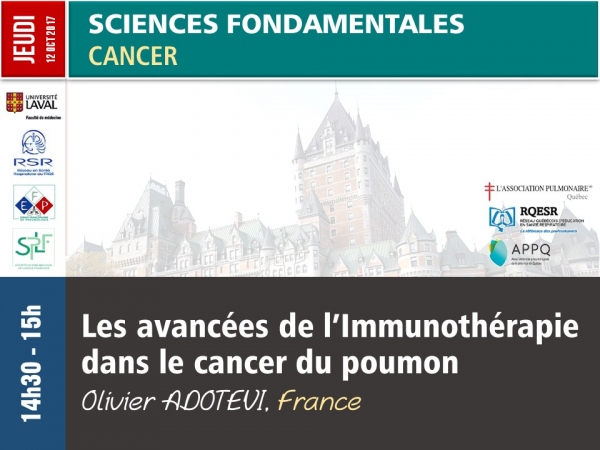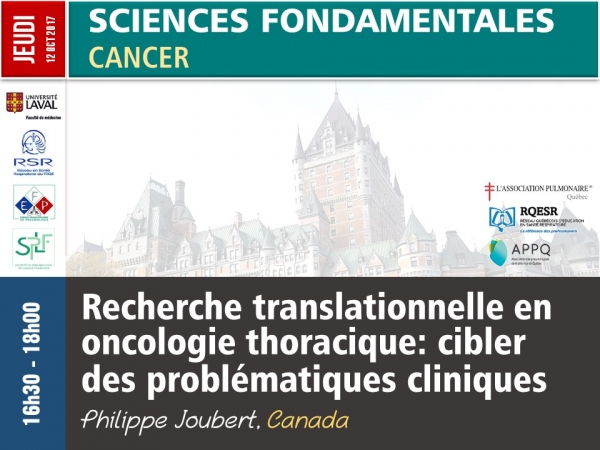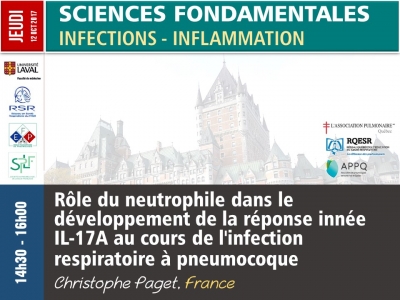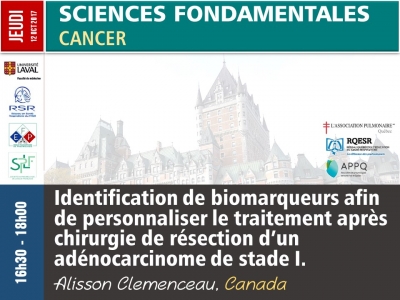Sciences fondamentales (5)
Objectifs Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
- comprendre le principe et le mode d’action des immunothérapies.
- Connaître les principales indications et efficacité de l’immuno-thérapie en oncologie thoracique.
- Discuter les principales stratégies d’amélioration en cours d’éva- luation (biomarqueur, combinaison thérapeutique...).
L’émergence de l’immuno-onconlogie (IO) a considérablement modifié la prise en charge thérapeutique en oncologie thoracique. En effet, l’utilisation d’anticorps bloquant les récepteurs appelés « immune checkpoints » tels que PD-1 et PDL-1 sont actuellement prescrites dans les cancers bronchiques avancées. ces traitements fonctionnent en réactivant les réponses immunitaires des patients.
Bien que l’immunothérapie a démontré une efficacité supérieur comparée à celle des traitements conventionnels notamment la chimiothérapie, le taux de réponse global est d’environ 20 % dans les cancers bronchopulmonaires. Par conséquent, plusieurs stratégies capables d’améliorer l’efficacité de l’immunothérapie font d’une recherche accélérée en particulier, l’utilité de biomarqueurs pré- dictifs de réponse et l’évaluation des combinaisons thérapeutiques
Longtemps considérée comme une cellule « mono-tâche » de la réponse immunitaire innée spécialisée dans l’élimination des pathogènes, le polynucléaire neutrophile tend aujourd’hui à être repositionné au cœur des processus d’immunorégulation dans la muqueuse pulmonaire.
En utilisant un modèle d’infection respiratoire invasif à la bactérie Streptococcus pneumoniae (le pneumocoque), nous mettons en évidence un rôle clé du neutrophile dans la produc- tion d’interleukine-17 par une sous-population de lymphocytes T γδ résidente du parenchyme pulmonaire. Le neutrophile exerce cette fonction via la sécrétion d’IL-1β de façon dépendante de l’inflamma- some nLRP3. D’un point de vue mécanistique, le fonctionnement du complexe inflammasome NLRP3 au sein des neutrophiles repose sur 1) la sécrétion de TnF-α par les macrophages alvéolaires et 2) la toxine bactérienne pneumolysine pour son activation. De façon intéressante, ce mécanisme est transposable sur des neutrophiles humains.
Notre travail révèle donc la dynamique cellulaire et moléculaire d’activation des lymphocytes T γδ producteurs d’IL-17 et met en évidence pour la première fois l’existence d’un inflammasome NLRP3 fonctionnel au sein des neutrophiles pulmonaires. cet axe immunitaire régule ainsi le développement de la réponse immune protectrice de l’hôte au cours des infections respiratoires bactériennes.
La famille des Paramyxoviridae contient plusieurs virus, incluant le virus respiratoire syncytial (RSV), causant des maladies respiratoires sévères pour lesquelles les stratégies thérapeutiques et vaccinales restent très limitées, voire inexistantes.
Le développement de résistances aux molécules ciblant les protéines virales pouvant diminuer l’efficacité des traitements à long terme, une alternative intéressante consiste à cibler les protéines de l’hôte impliquées dans les interactions hôte/virus qui contrôlent soit la réplication virale, soit la réponse autonome antivirale ou la réponse proinflammatoire. cependant, les mécanismes d’interaction des Paramyxovirus avec les cellules de l’hôte, particulièrement les cellules épithéliales, restent encore largement inconnus. Nos recherches ont permis d’identifier plusieurs protéines de l’hôte qui sont impliquées dans la régulation de la réponse antivirale dans les cellules épithéliales des voies aériennes. Plus particulièrement nous nous sommes intéressés aux récepteurs cytoplasmiques de la famille des récepteurs de type RIg- I, RIg-I et MDA5, et à leur contribution respective à la détection des Paramyxovirus dans les cellules épithéliales. nous avons également identifié des enzymes de type NADPH oxydase, NOX2 et DUOX2, dont l’activité productrice de dérivés actifs de l’oxygène contribue à la régulation de la production de cytokines antivirales et proinflammatoires.
Nos études permettent non seulement une meilleure compréhension des mécanismes impliquant des protéines cellulaires dans le développement d’une réponse antivirale autonome dans l’infection à Paramyxovirus respiratoires, mais ouvrent également de nouvelles options dans le contrôle thérapeutique de cette réponse.
Objectif Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer au canada. Le taux de survie à 5 ans est de 17 %. La résection chirurgicale demeure le meilleur espoir curatif des patients. cependant, 30 à 50 % récidivent suite à cette intervention et aucun outil clinique n’est disponible afin de prédire les risques des patients opérés. L’objectif de ce projet est d’identifier des biomarqueurs associés à la survie suivant une résection chirurgicale d’un adénocarcinome de stade 1.
Méthodes Les gènes candidats ont été sélectionnés grâce à une revue de littérature, ainsi qu’à l’analyse de bases de données publiques (PREcOg). L’une de nos bases de données, dans laquelle l’expression des gènes a été quantifiée à l’aide de biopuces à ADN dans la tumeur et le parenchyme pulmonaire non-tumoral à 0, 2, 4 et 6 cm de la tumeur a également été analysée. L’expression des gènes a ensuite été mesurée par qPcR sur 244 échantillons d’adénocarcinomes de stade 1. Des analyses de Kaplan-Meier ont été réalisées pour évaluer leur valeur pronostique.
Résultats Dix gènes ont été sélectionnés selon leur capacité à prédire une récidive ou une rémission grâce aux données publiques. Les analyses complémentaires sur notre base de données ont permis de réduire la liste à 3 gènes associés à un mauvais pronostique (RRM1, EZH2 et FOXM1) et 2 gènes associés à un bon pronostique (BTG2, SELEnBP1). Les analyses de EZh2 et de RRM1 par qPcR ont révélées des courbes de survies significativement différentes entre les patients avec des niveaux d’expression géniques élevés et faibles EZh2 Kaplan- Meier log-rank ; p = 0,04, RRM1 Kaplan-Meier log-rank ; p = 0,0003). En revanche, celles de BTG2, SELENBP1, et FOXM1 ne montrent pas de différences significatives. Les analyses des gènes EZH2 et RRM1 sur une cohorte de validation indépendante sont en cours.
Conclusion nos résultats supportent le rôle des gènes EZh2 et RRM1 comme biomarqueurs afin de prédire la récidive des adéno- carcinomes de stade 1.